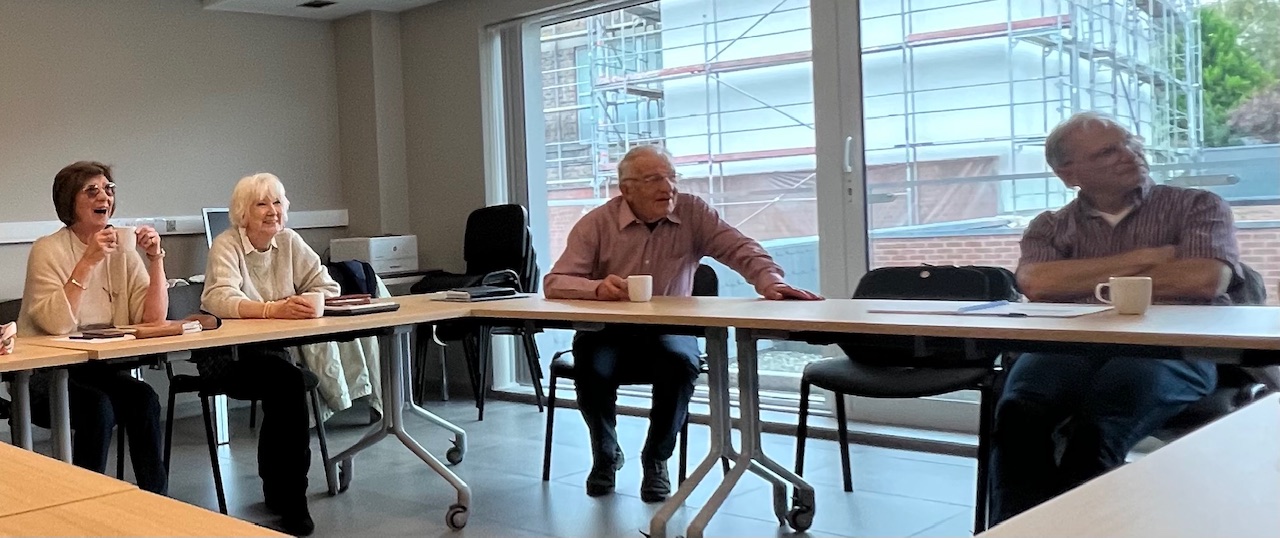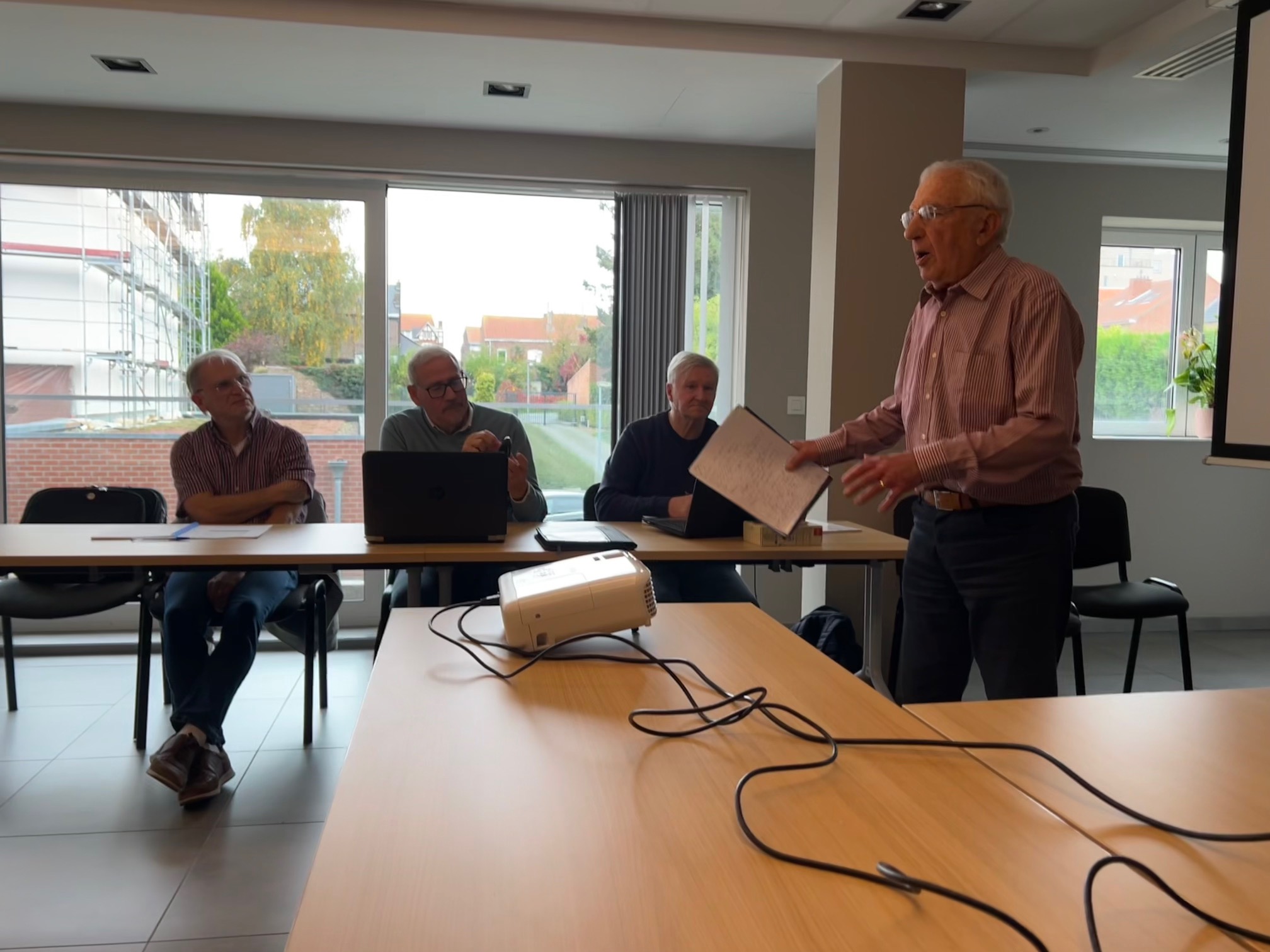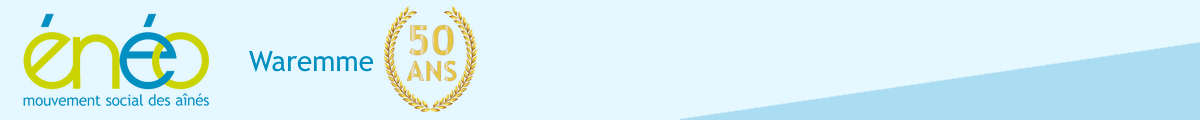Pour compléter notre arbre généalogique, nous avons régulièrement recours aux outils que sont les registres d’état civil d’abord, puis, en remontant le temps, avant 1793 :
les registres paroissiaux.
Ils sont tenus dans les paroisses et complétés par les curés.
Ils n’ont pas été rendus obligatoires (dans notre pays qui était la Principauté de Liège pendant plus de 800 ans) par les Princes-Evêques.
Mais qui a alors donné l’ordre de tenir ces registres paroissiaux ?
On serait tenté de croire que ce qui est à l’origine de ces registres ce sont des instructions de la hiérarchie ecclésiastique.
En 1500 le registre paroissial généralisé n’existait pas.
Quelle a été la raison d’être de ces registres ? Où cela a-t-il commencé et pourquoi ?
Pour rendre valablement un jugement il est important de savoir si la personne à juger est majeure ou non afin de déterminer sa responsabilité.
FRANÇOIS 1er, roi de France de 1515 à 1547, demanda à l’un de ses conseillers privés, l’avocat Guillaume POYET de rédiger une ordonnance royale imposant aux curés de tenir dans chaque paroisse de France un registre des baptêmes en notant la date précise de la naissance (jour et heure), le prénom de l’enfant ainsi que les nom et prénom du père. L’ordonnance stipulait également que la langue de la justice était le français.
N.B. Il est choquant de constater que ces actes ne mentionnent nullement le nom de la mère. Cela nous éclaire sur la place de la femme dans la société de l’époque et nous surprend.
Le but de ces registres était donc de pouvoir déterminer si le sujet était mineur ou non.
Cette ordonnance est aussi appelée l’ordonnance GUILLEMINE en référence à son auteur ou l’ordonnance de VILLERS-COTTERÊT de 1539.
Par cette ordonnance, TOUS les curés de FRANCE vont devoir tenir un registre précis des baptêmes.
Mais comment se fait-il que le roi donne des ordres au clergé ?
Pour comprendre il faut se replacer dans le contexte historique de l’époque.
La Basilique Saint-Pierre de Rome a été reconstruite à partir 1506. Mais on a vu beaucoup trop grand et au bout de quelques années les fonds vont manquer. Le pape Léon X va vendre des indulgences pour financer la poursuite de la construction.
Cette décision ne fait pas l’unanimité (loin de là) et Luther va la contester par ses écrits de 1517 et lancer la Réforme protestante. Il fut suivi en France par Calvin.
A la même époque le Roi d’Angleterre Henri VIII voulut que le pape proclamât la nullité de son mariage parce que sa femme ne lui donnait qu’une descendance féminine. Le pape refusa et ce fut le point de départ du conflit entre Henri VIII et la papauté qui mena à l’Anglicanisme.
Le pontificat du pape Clément VII démarra en 1523 à un moment où l’autorité du pape était contestée de différentes parts. Aussi conclut-il un accord avec le roi FRANÇOIS 1er : en contrepartie de son allégeance le roi obtint le droit de nommer les évêques de France. Ce pouvoir lui assura un certain contrôle de l’église de France et lui permit d’avoir certaines exigences vis-à-vis des curés. Cela explique son ordonnance pour la tenue des registres de baptêmes en France.
Mais peu après le Pape Paul III, pour réagir à la Réforme protestante, convoque le Concile de Trente en 1545. Ce Concile se tint par épisode et se termina en 1563 et obligera les prêtres à enregistrer les sacrements (baptêmes, mariages et décès) et ce, pour toute la chrétienté.
Du besoin des juges français de pouvoir déterminer la majorité d’un sujet, on arrive moins de 25 ans plus tard à des registres imposés dans tous les pays Une fois la démarche amorcée elle s’est rapidement amplifiée
Ces registres, qui nous paraissent très incomplets, lacunaires, répondaient en fait à la demande pour laquelle ils avaient été prévus.
Registres d’État Civil
Après la Révolution française de 1789 il y a eu séparation entre l’Église et l’État. On parle parfois de déchristianisation. Des églises (surtout en France) ont été nationalisées, parfois vendues et démolies, des ornements paroissiaux confisqués et vendus aux enchères.
C’est ainsi qu’une loi de 1792 impose aux autorités civiles l’obligation de tenir des registres d’état civil. Et ils seront pour nous, qui nous occupons de généalogie, plus complets pour répondre aux besoins de l’époque. La gestion de l’état civil moderne est née de cette loi de 1792.
Ces registres tenus par les communes à partir de 1793 n’ont pas beaucoup évolué sur 230 ans. Mais l’attribution d’un numéro national a ouvert la voie à de nouvelles utilisations : déclarations de contributions, mutuelle, permis de conduire …
Consultation des registres
Pour rappel, les actes de décès de plus de 75 ans sont librement consultables, soit via Agatha soit via l’agent de l’état civil de la commune où l’acte a été dressé.
Il en va de même pour les actes de mariages de plus de 75 ans et pour les actes de naissance de plus de 100 ans.
Pour ce qui est des actes plus récents une copie intégrale sera fournie sur demande par la commune où l’acte a été dressé (parfois moyennant un coût très variable) pour autant qu’on prouve sa parenté directe. Sinon pour consultation des registres une dérogation est nécessaire en écrivant au juge de Paix du lieu concerné.
Jean-Marie Smets
(résumé de son exposé d’octobre pour la généalogie)
Vous pouvez agrandir les photos en cliquant dessus …